LA PIERRE
De la pierre brute à la pierre taillée et maçonnée, nulle ville n’est plus associée à ce matériau que ne l’est Chauvigny. Exploitées de façon industrielle depuis le 19 e siècle, les carrières du bassin Chauvinois ont fourni les matériaux pour la construction de nombreux monuments locaux mais aussi dans toute la France et à l’étranger. L’exploitation contemporaine du calcaire de Chauvigny est mise en relation avec la chaîne opératoire du silex à l’époque Néolithique.
-
 Il s’agit d’un calcaire oolithique (du grec oon : œuf et lithos : pierre) qui s’est déposé à l’ère secondaire, époque Jurassique moyen, étage Bathonien : il y a environ 165 millions d’années, lorsque la mer s’est retirée du territoire. Ce calcaire est composé de grains de différentes tailles ; plus les grains sont gros, plus la mer était agitée et inversement. Ce sont ces grains qui font de la pierre de Chauvigny, une pierre de qualité, facile à travailler et résistant aux intempéries, notamment au gel.
Il s’agit d’un calcaire oolithique (du grec oon : œuf et lithos : pierre) qui s’est déposé à l’ère secondaire, époque Jurassique moyen, étage Bathonien : il y a environ 165 millions d’années, lorsque la mer s’est retirée du territoire. Ce calcaire est composé de grains de différentes tailles ; plus les grains sont gros, plus la mer était agitée et inversement. Ce sont ces grains qui font de la pierre de Chauvigny, une pierre de qualité, facile à travailler et résistant aux intempéries, notamment au gel.
En revanche, pour éviter que la pierre n’éclate dans les foyers de cheminée, des briques ou des tuiles pouvaient être disposées pour absorber la chaleur. C’est notamment le cas au donjon de Gouzon (voir photo) et au château d’Harcourt. -
 Les outils de carriers accrochés au mur sont encore en usage jusqu’au milieu du 19e siècle. Historiens et archéologues s’accordent à dire que les outils utilisés au Moyen Âge et ceux utilisés à l’époque moderne sont les mêmes. Il n’y a pas vraiment eu d’évolution de l’outillage.
Les outils de carriers accrochés au mur sont encore en usage jusqu’au milieu du 19e siècle. Historiens et archéologues s’accordent à dire que les outils utilisés au Moyen Âge et ceux utilisés à l’époque moderne sont les mêmes. Il n’y a pas vraiment eu d’évolution de l’outillage.
Les blocs étaient généralement extraits à la pioche mais pour les endroits inaccessibles, une lance (grande barre en fer aux extrémités ouvragées) permettait d’achever le travail par percussion. Une fois le bloc décollé, il était basculé dans la carrière, sur des pierres concassées, pour éviter qu’il ne se fracture. Il était ensuite débité en fonction des commandes.
Jusqu’en 1940, le crocodile est utilisé pour la découpe. Un seul carrier pouvait utiliser cette scie monumentale car elle n’est pourvue que d’un manche. En effet, dans la pierre contrairement au bois, la densité de la poussière est telle qu’il est impossible de faire de mouvement d’aller-retour. La tâche était donc particulièrement fastidieuse.
Puis en 1940, les premières tronçonneuses à pierre apparaissent, pour des raisons militaires dans un premier temps. L’outil est lourd et encombrant mais permet un gain de temps considérable. -
 Le cric est le premier outil mécanique utilisé dans les carrières. Il est associé au levier pour soulever les blocs et les mettre sur des charrettes. Jusqu’au milieu du 19e siècle, on utilise pratiquement que des charrettes. C’est seulement à la fin du 19e siècle que se généralise l’usage des chemins de fer : la production s’industrialise. Il est facile d’emmener les blocs jusqu’au port et de les distribuer par bateau dans le monde entier. Dans les années 20, c’est l’apparition des camions qui facilitera le transport car le chemin de fer ne dessert pas toutes les destinations.
Le cric est le premier outil mécanique utilisé dans les carrières. Il est associé au levier pour soulever les blocs et les mettre sur des charrettes. Jusqu’au milieu du 19e siècle, on utilise pratiquement que des charrettes. C’est seulement à la fin du 19e siècle que se généralise l’usage des chemins de fer : la production s’industrialise. Il est facile d’emmener les blocs jusqu’au port et de les distribuer par bateau dans le monde entier. Dans les années 20, c’est l’apparition des camions qui facilitera le transport car le chemin de fer ne dessert pas toutes les destinations.
-
 Une fois la pierre sur le chantier, un autre corps de métier intervient : les tailleurs de pierre. Ils utilisent la massette et la chasse pour dégrossir le travail, puis les ciseaux, la gradine, la sciotte, qui est une petite scie qui sert à marquer la pierre. L’outil caractéristique des tailleurs est le rabot chemin de fer. Il est constitué de plusieurs lames, chaque rabot doit s’adapter à la forme commandée. Pour chaque forme, il faut un rabot adéquat, ce qui fait qu’un tailleur de pierre pouvait en avoir jusqu’à 50 !
Une fois la pierre sur le chantier, un autre corps de métier intervient : les tailleurs de pierre. Ils utilisent la massette et la chasse pour dégrossir le travail, puis les ciseaux, la gradine, la sciotte, qui est une petite scie qui sert à marquer la pierre. L’outil caractéristique des tailleurs est le rabot chemin de fer. Il est constitué de plusieurs lames, chaque rabot doit s’adapter à la forme commandée. Pour chaque forme, il faut un rabot adéquat, ce qui fait qu’un tailleur de pierre pouvait en avoir jusqu’à 50 !
Dans le travail de pierre, seules les parties visibles vont être polies. Les endroits cachés, ceux en contact avec le mortier, sont laissés brut, pour permettre une meilleure adhésion. -
 C’est lors du labour d’un champ en bord de Vienne, à 6 km de Chauvigny, que cette sépulture a été mis au jour ; d’abord par l’élévation d’une dalle par la charrue puis par le travail des archéologues.
C’est lors du labour d’un champ en bord de Vienne, à 6 km de Chauvigny, que cette sépulture a été mis au jour ; d’abord par l’élévation d’une dalle par la charrue puis par le travail des archéologues.
Il s’agit d’une tombe néolithique datée de 5 000 ans avant J.-C.. Cette période correspond à la sédentarisation des hommes, le début de l’agriculture et de l’élevage. D’autres sépultures ont été retrouvées à proximité lors de crues de la Vienne. Initialement cette zone cimetière avait été choisie car elle était suffisamment élevée par rapport au niveau de la rivière.
Cette sépulture est composée de dalles, façonnées quelques centaines de mètres plus loin dans une zone calcaire. Elles ont une épaisseur moyenne de 5 cm, ce qui les rend très fragiles et implique une technique de déplacement rodée. À l’intérieur de la pierre, la paroi est aplanie, ce qui signifie qu’avec un outil, certainement un percuteur en silex, on a martelé la pierre de façon à obtenir cette paroi.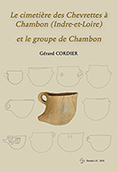 Pour en savoir plus : Le cimetière des Chevrettes à Chambon (Indre-et-Loire) et le groupe de Chambon — en vente à l’accueil, prix : 30 €
Pour en savoir plus : Le cimetière des Chevrettes à Chambon (Indre-et-Loire) et le groupe de Chambon — en vente à l’accueil, prix : 30 € -